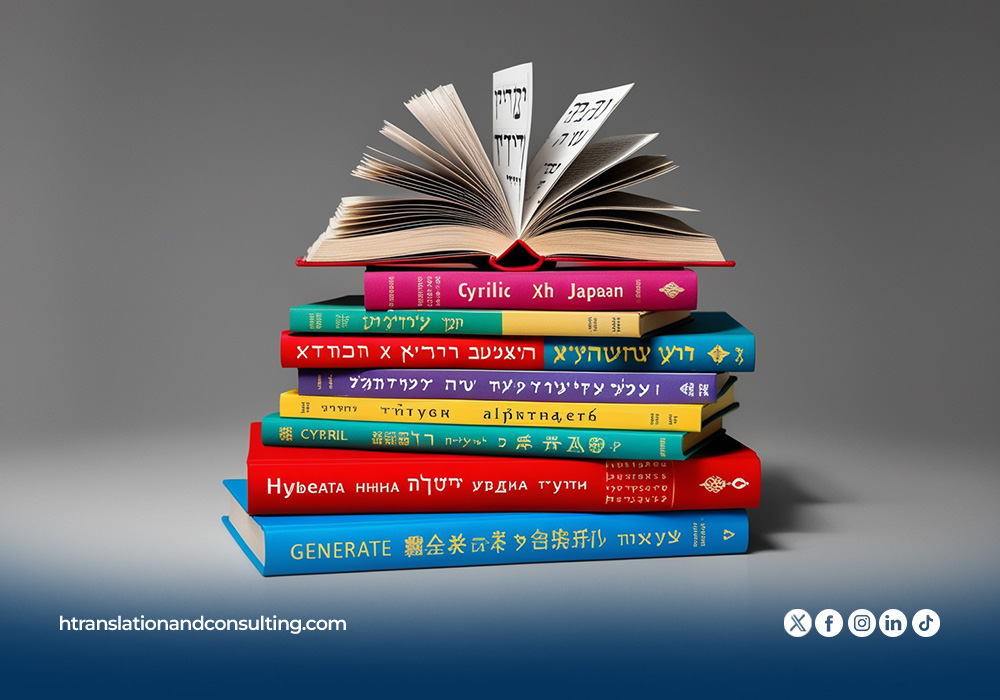
L’histoire de la linguistique et des relations interculturelles révèle une tendance récurrente chez les peuples à surestimer la valeur de leur propre langue tout en dépréciant celles des autres. Ce phénomène, que l’on peut qualifier de chauvinisme linguistique, a des racines profondes dans l’histoire de l’humanité et continue d’influencer les perceptions et les politiques linguistiques jusqu’à nos jours. Une analyse approfondie de cette tendance nous permet de mieux comprendre les dynamiques complexes qui régissent la vitalité et le déclin des langues dans le monde contemporain.
Dès l’Antiquité, les Grecs ont établi une distinction nette entre leur langue, considérée comme le summum de la sophistication, et toutes les autres, qu’ils qualifiaient de “barbares”. Ce terme, dérivé de l’onomatopée “bar bar” censée imiter les sons incompréhensibles des langues étrangères, illustre parfaitement la perception ethnocentrique qui a longtemps dominé les relations linguistiques. Cette attitude n’était pas l’apanage des Grecs ; on la retrouve dans de nombreuses cultures à travers l’histoire, chacune considérant sa langue comme supérieure aux autres.
En France, particulièrement, la hiérarchisation des langues a été une préoccupation constante des élites intellectuelles. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le rayonnement international du français, tant comme langue littéraire que comme lingua franca remplaçant le latin dans les échanges diplomatiques et scientifiques, a solidement ancré dans l’esprit des Français l’idée de la supériorité intrinsèque de leur langue. Il est intéressant de noter que cette perception s’est développée alors même que le français n’était parlé que par une minorité de la population européenne, environ cinq millions de personnes, principalement issues de l’élite.
Ce sentiment de supériorité linguistique a perduré et s’est transformé au fil du temps. Aujourd’hui, le nombre de francophones est passé à plus de cent millions, voire davantage si l’on inclut les populations des États francophones d’Afrique, bien que la maîtrise effective du français dans ces pays soit souvent limitée à une fraction de la population. Paradoxalement, cette expansion numérique s’accompagne d’une prise de conscience croissante du déclin relatif de la langue française sur la scène internationale.

Face à ce constat, on observe une évolution du chauvinisme linguistique français, qui passe d’une posture triomphante à une attitude défensive. Cette transformation se reflète dans les efforts de sensibilisation du grand public à la “beauté” et à la “richesse” de la langue française, comme l’illustre la chanson d’Yves Duteil, “La Langue de chez nous”. Ces initiatives, bien qu’elles puissent renforcer l’attachement affectif à la langue, soulèvent des questions quant à leur efficacité réelle pour maintenir la vitalité du français dans un contexte mondial en rapide évolution.
L’exemple des Cajuns de Louisiane est particulièrement révélateur de cette dynamique. Leur fierté affichée envers la langue française, exprimée dans un français approximatif, peut être interprétée comme un signe de la fragilité de leur héritage linguistique plutôt que comme une preuve de sa vitalité. En effet, la nécessité de proclamer sa fierté linguistique est souvent un indicateur de l’insécurité et du déclin d’une langue, contrairement aux locuteurs de langues dominantes qui n’éprouvent généralement pas le besoin d’affirmer leur attachement linguistique.
Il est crucial de comprendre que la vitalité d’une langue ne dépend pas de qualités intrinsèques telles que sa beauté, sa logique, sa souplesse ou son efficacité communicative. Ces attributs, souvent invoqués par les défenseurs d’une langue, sont en réalité des constructions subjectives qui ne déterminent pas la capacité d’une langue à se maintenir ou à se propager. La véritable force d’une langue réside dans la vitalité des peuples qui la parlent, reflétant leur influence économique, politique et culturelle.
Historiquement, cette vitalité linguistique s’est souvent manifestée à travers des processus de colonialisme et d’impérialisme. Le cas de la France est emblématique à cet égard : l’unification linguistique du pays s’est réalisée au détriment des langues régionales, dont beaucoup ont été marginalisées ou ont disparu. Ce processus, bien que controversé d’un point de vue éthique, illustre comment la domination politique et économique peut influencer profondément le paysage linguistique d’un territoire.
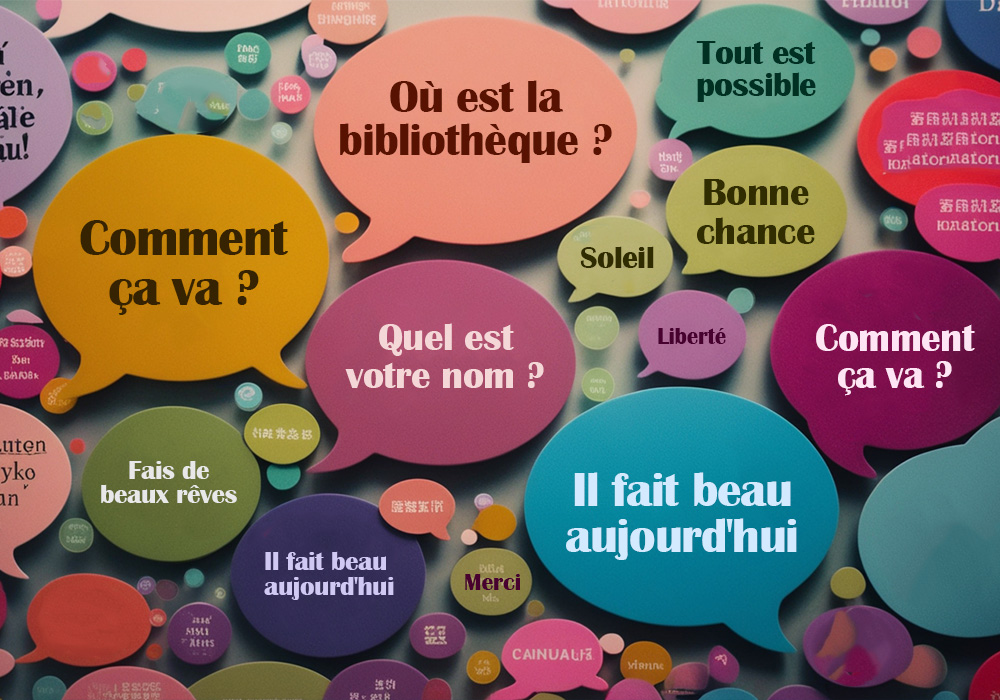
Dans le contexte actuel de la francophonie, particulièrement en Afrique, le maintien du français est moins lié à un attachement sentimental qu’à des considérations pragmatiques. La valeur du français sur le marché de l’emploi et dans les échanges économiques est le facteur déterminant de sa persistance. Cette réalité souligne la fragilité potentielle de la position du français : un changement dans les dynamiques économiques ou géopolitiques pourrait rapidement modifier les choix linguistiques des élites et des populations.
Il est essentiel de reconnaître qu’une langue constitue une forme de capital dont la valeur est sujette aux fluctuations du marché mondial des langues. Le capital représenté par une bonne maîtrise du français standard peut s’avérer insuffisant dans un contexte où d’autres compétences linguistiques, notamment en anglais, sont de plus en plus valorisées. Dans cette perspective, la création de contenus et d’outils technologiques en français pourrait s’avérer plus efficace pour maintenir la pertinence de la langue que les discours sur sa beauté ou sa clarté.
Néanmoins, cette approche pragmatique ne doit pas occulter l’importance de l’attachement affectif à sa langue maternelle. L’amour d’une langue et la reconnaissance de sa valeur culturelle et identitaire sont des aspects légitimes et importants de l’expérience linguistique. Cependant, il est crucial de distinguer cet attachement personnel des réalités socio-économiques qui déterminent la vitalité et la diffusion des langues à l’échelle mondiale.
Conclusion
En conclusion, l’évolution du chauvinisme linguistique français, passant d’une posture de domination à une attitude défensive, reflète les changements profonds dans la position du français sur la scène internationale. Cette transformation nous invite à repenser notre approche de la promotion et de la préservation des langues. Plutôt que de s’appuyer sur des arguments essentialistes sur la supériorité intrinsèque d’une langue, il serait plus pertinent de se concentrer sur le renforcement de sa valeur pratique et de son utilité dans les domaines clés de l’économie, de la technologie et de la culture. Parallèlement, il est important de cultiver une appréciation de la diversité linguistique mondiale, reconnaissant que chaque langue, indépendamment de son statut ou de son nombre de locuteurs, représente une façon unique d’appréhender et d’exprimer l’expérience humaine.
Jocelyn Godson HÉRARD, Copywriter H-translation.

