Comment définir la maîtrise du langage humain ? Longtemps associée à des règles universelles et autonomes, la notion de compétence langagière s’est progressivement enrichie pour intégrer les dimensions pragmatiques, discursives et interactives. Cet article explore l’évolution des théories, des critiques au modèle initial jusqu’aux perspectives contemporaines centrées sur la complexité et l’adaptabilité du langage.

La compétence linguistique, notion phare introduite par Noam Chomsky dans les années 1960, a profondément influencé les champs de la linguistique et de la psycholinguistique. En définissant cette compétence comme une capacité innée et universelle de générer et comprendre un nombre infini de phrases grammaticales, Chomsky visait à modéliser les structures fondamentales du langage humain. Cette approche, reposant sur une grammaire générative, postulait que les lois du langage se situent en grande partie au-delà de l’expérience individuelle, relevant d’une sorte de programmation cognitive universelle inscrite dans la biologie humaine.
Cependant, la notion de compétence linguistique telle que conçue par Chomsky n’a pas tardé à susciter critiques et remises en question. L’idée d’un système autonome de règles syntaxiques a été confrontée aux recherches sur la sémantique, la pragmatique et la sociolinguistique, révélant une complexité du langage qui excède largement les dimensions purement syntaxiques. Cette richesse a conduit à élargir la notion initiale en y intégrant des dimensions communicatives, discursives et contextuelles, souvent regroupées sous le terme plus englobant de « compétence langagière ». Ce passage d’une vision rigide et normative à une conception plus ouverte et multifactorielle illustre les évolutions méthodologiques et théoriques dans les sciences du langage.
Les linguistes, en élargissant le champ d’analyse, ont insisté sur l’importance de l’articulation entre la syntaxe et d’autres dimensions du langage. Par exemple, la grammaire générative, dans sa version initiale, tendait à minimiser le rôle de la sémantique et du contexte. Or, il est devenu évident que la signification des énoncés et leur interprétation pragmatique ne peuvent être isolées de leur dimension syntaxique. La question de l’interaction entre ces différentes composantes a ouvert de nouvelles perspectives pour comprendre le langage comme un système dynamique et intégré.
Parallèlement, les recherches psycholinguistiques ont également révélé les limites du modèle chomskyen. En cherchant à démontrer l’existence psychologique de la compétence linguistique, les premières études ont rencontré des difficultés à valider les hypothèses d’un isomorphisme entre les règles syntaxiques formelles et les processus cognitifs réels. Les résultats obtenus sur la compréhension des phrases passives, par exemple, ont montré des variations importantes liées au sens et au contexte, remettant en question la prédominance exclusive de la syntaxe.
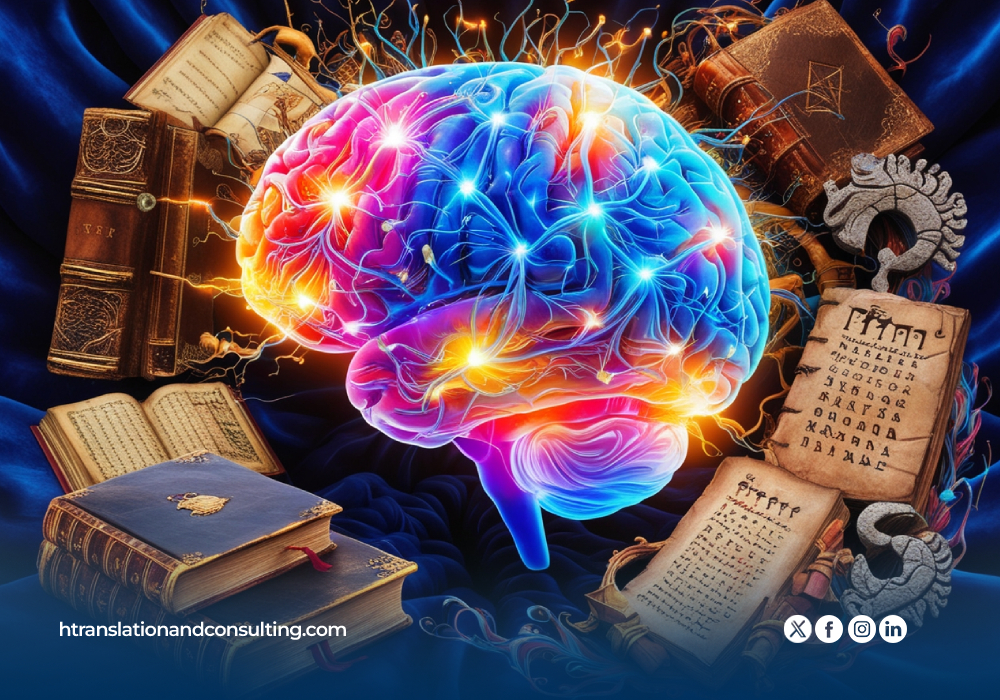
Dans cette perspective, les approches contemporaines du langage mettent davantage l’accent sur les interactions sociales et les stratégies discursives. La communication humaine ne se limite pas à la production de phrases grammaticales; elle implique une aptitude à adapter son discours en fonction des interlocuteurs, du contexte et des intentions. Cette prise en compte des dimensions pragmatiques et discursives a conduit à redéfinir la compétence langagière comme une aptitude à gérer la complexité de situations variées, en mobilisant des savoir-faire multiples allant bien au-delà de la grammaire.
L’élargissement de la notion de compétence langagière s’accompagne toutefois de nouveaux défis théoriques. Les tentatives d’intégration des différentes composantes – syntaxiques, sémantiques, pragmatiques – dans un modèle global se heurtent à la diversité des contextes et des pratiques linguistiques. Plutôt que de chercher une théorie universelle, les chercheurs tendent aujourd’hui à proposer des modèles locaux adaptés à des situations spécifiques. Ces approches, tout en étant plus modestes, permettent d’aborder la complexité du langage de manière plus empirique et contextuelle.

En conclusion, l’évolution de la notion de compétence langagière reflète les transformations des sciences du langage au cours des dernières décennies. En passant d’un modèle formel et universel à une conception plus ouverte et contextualisée, les recherches sur le langage se sont enrichies d’une compréhension plus fine de sa diversité et de sa complexité. Si cette évolution ne permet pas encore d’aboutir à une théorie générale unifiée, elle ouvre des voies prometteuses pour l’étude des pratiques langagières et leurs applications en didactique, en psychologie et en intelligence artificielle.
Jocelyn Godson HÉRARD, Copywriter H-Translation

