Cet article est une adaptation d’une étude fondamentale sur les structures syntaxiques des créoles français, initialement publiée par Marguerite Saint-Jacques-Fauquenoy en 1970. Le texte original, intitulé “Le verbe ‘être’ dans les créoles français”, présentait une analyse détaillée des différentes manifestations et fonctions du verbe “être” dans plusieurs variétés de créoles français. Cette version révisée conserve la richesse analytique de l’article source tout en proposant une approche plus accessible et une structure narrative fluide. L’argumentation originale a été préservée, mais réorganisée dans un format plus contemporain, permettant aux lecteurs de mieux appréhender les subtilités linguistiques des créoles français. Cette adaptation vise à mettre en lumière les découvertes significatives de Saint-Jacques-Fauquenoy sur les mécanismes grammaticaux particuliers développés par les langues créoles pour exprimer les fonctions traditionnellement assumées par le verbe “être” en français standard.
Le verbe “être” dans les créoles français présente des particularités syntaxiques et sémantiques qui méritent une analyse approfondie. Cette étude se concentre principalement sur le créole guyanais, tout en établissant des comparaisons pertinentes avec d’autres variétés créoles, notamment l’haïtien, le martiniquais, le guadeloupéen, le dominicain et le mauricien, en s’appuyant sur les travaux de divers chercheurs dont Goodman, Valdman, d’Ans, Jourdain, Taylor et Baissac.
En français, le verbe “être” remplit trois fonctions distinctes : il peut signifier l’existence, servir d’auxiliaire temporel, ou jouer le rôle de copule. Dans les créoles français, la première fonction, celle d’existence, est absente. Comme l’observait Baissac (1880) pour le mauricien, le concept d’existence sans attribut dépasse les capacités d’abstraction de ces langues. Cette lacune est comblée par l’utilisation de verbes synonymes tels que “gagner” ou “avoir” en guyanais, “tenir” en martiniquais, ou encore “yeka” en mauricien.
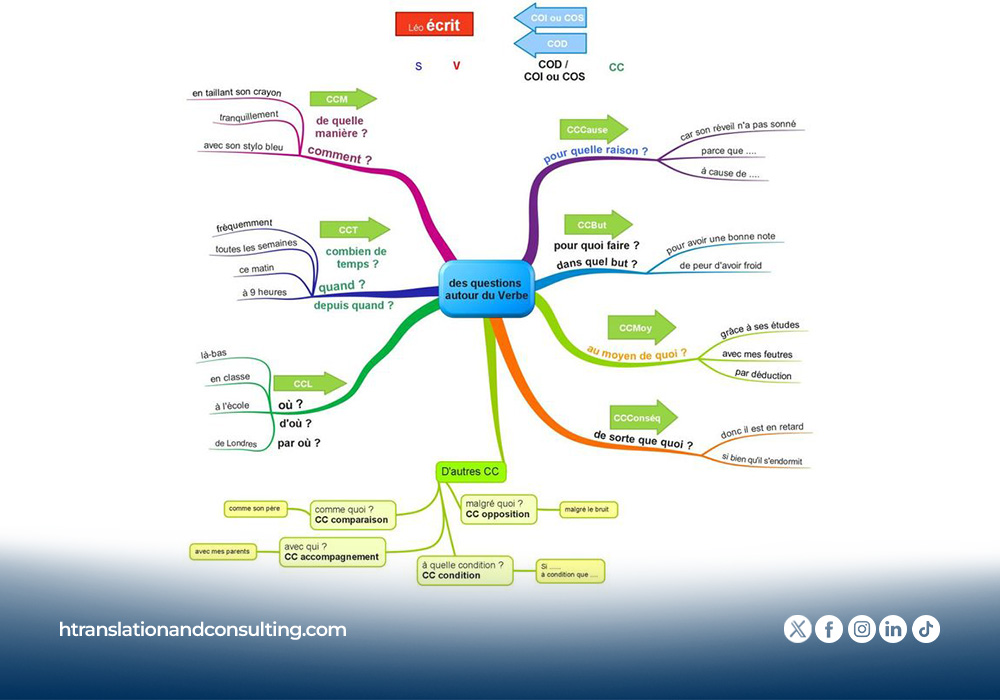
Concernant la fonction d’auxiliaire, certains chercheurs ont suggéré un lien entre la particule aspectuelle “té” et une forme flexionnelle du verbe “être”. Cependant, l’analyse synchronique révèle que cette particule fonctionne différemment de l’auxiliaire français. En guyanais par exemple, le système verbal s’articule autour de six particules aspectuelles, dont “té” qui, seule ou combinée à d’autres particules, exprime diverses nuances temporelles et aspectuelles. Cette particule remplace indifféremment les auxiliaires “être” et “avoir” du français, suggérant une réalité grammaticale distincte.
La fonction copulative du verbe “être” dans les créoles français se manifeste de façon particulière. En guyanais, lorsque le prédicat est un adjectif ou un adverbe, l’énoncé prédicatif se réalise par simple juxtaposition des termes, sans copule formelle. La prédication est marquée par une pause et un schéma d’intonation spécifique, un phénomène que Göbl-Galdi nomme “l’accent-copule”. Quand le prédicat est un nom ou un pronom, le morphème “sa” peut apparaître entre le sujet et le prédicat. Ce morphème n’est pas toujours indispensable, mais devient nécessaire pour lever certaines ambiguïtés structurelles.
Dans les autres créoles étudiés, notamment les variétés antillaises et l’haïtien, on observe des constructions similaires impliquant les morphèmes “sé”, “yé” et “eté”. Ces éléments apparaissent dans différents contextes syntaxiques : énoncés affirmatifs à prédicat non verbal, énoncés à prédicat introduit par un présentatif grammatical, énoncés interrogatifs, et constructions à inversion emphatique. L’analyse révèle que ces morphèmes, plutôt que de représenter véritablement le verbe “être”, fonctionnent comme des pronoms copules ou des marqueurs grammaticaux spécifiques.
En conclusion, les créoles français ont développé des stratégies alternatives pour exprimer les fonctions traditionnellement assumées par le verbe “être” en français. L’existence s’exprime par des verbes synonymes, l’auxiliaire est remplacé par des particules aspectuelles, et la fonction copulative est assurée soit par une copule zéro marquée prosodiquement, soit par des pronoms copules lorsque le message risque d’être ambigu. Cette organisation grammaticale particulière témoigne de la créativité linguistique des langues créoles dans leur développement d’un système efficace avec un minimum de signifiants.
Jocelyn Godson HÉRARD, Copywriter H-Translation

