Les langues ne sont ni figées ni homogènes. Cet article explore la manière dont les théories linguistiques, à l’instar des sciences physiques, s’adaptent pour comprendre les dynamiques complexes des pratiques langagières contemporaines. Inspiré des travaux de Mortéza Mahmoudian, tiré de son article original publié dans La Linguistique (2009), il revisite les concepts d’hétérogénéité, d’ouverture et de structure. Ce texte, riche en perspectives, propose une réflexion scientifique sur les évolutions méthodologiques nécessaires pour appréhender la richesse du langage humain.
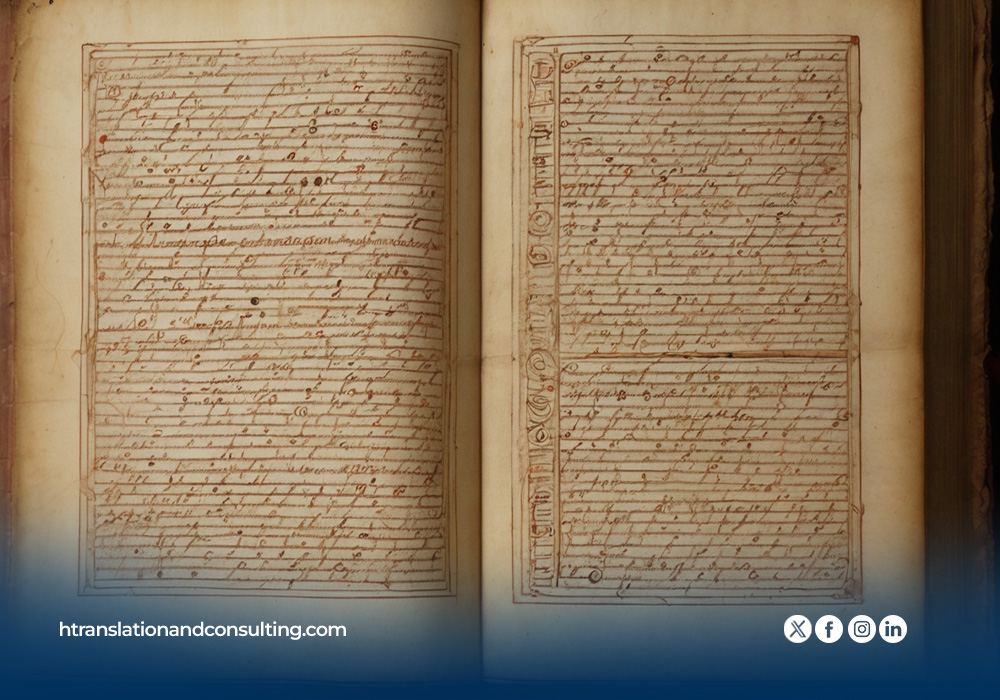
La linguistique, en tant que discipline scientifique, a longtemps reposé sur des postulats de stabilité et d’homogénéité. Ces concepts, hérités d’une époque où les sciences humaines aspiraient à adopter les méthodes des sciences naturelles, ont permis des avancées notables. Pourtant, les phénomènes langagiers se révèlent bien plus complexes, nécessitant une révision des cadres théoriques traditionnels. Cette révision implique une reconnaissance de l’hétérogénéité des langues, une ouverture sur leurs interactions et un élargissement des fonctions attribuées au langage.
La question de l’hétérogénéité est essentielle. Les langues ne peuvent être envisagées comme des systèmes homogènes partagés uniformément par une communauté. André Martinet, dans ses travaux, souligne que toute communauté linguistique est intrinsèquement hétérogène, non seulement en raison de clivages géographiques et sociaux, mais également à travers les pratiques individuelles qui s’y déploient (Martinet, 1960). Cette pluralité interne remet en cause l’idée d’un système linguistique clos, une observation déjà évoquée par Leonard Bloomfield lorsqu’il décrit les langues comme des ensembles ouverts influencés par leurs contextes sociaux et culturels (Bloomfield, 1957). Cette hétérogénéité a des implications majeures pour l’analyse linguistique, nécessitant une prise en compte des variations à tous les niveaux, qu’elles soient macroscopiques ou microscopiques.
L’ouverture constitue une autre caractéristique fondamentale des langues. Les interactions constantes entre langues, dialectes et registres illustrent leur nature perméable. Ces dynamiques linguistiques ont des conséquences notables sur les pratiques des locuteurs. Par exemple, dans les situations de contact linguistique, les emprunts, les métissages et les acculturations enrichissent le système sans pour autant en effacer les tensions internes. Cette porosité des frontières linguistiques a été abordée dans les études de Weinreich, qui souligne l’importance des phénomènes de chevauchement entre langues (Weinreich, 1953). Elle reflète aussi une réalité sociale : l’individu moderne est souvent le lieu d’une pluralité d’appartenances, illustrant l’idée que les langues ne peuvent être isolées des autres.

La remise en question de la fonction communicationnelle du langage complète ce tableau. Si la linguistique structurale a traditionnellement attribué un rôle central à la communication dans la structuration des langues, des travaux plus récents montrent que l’appartenance sociale ou culturelle peut primer sur l’intercompréhension. Cela est manifeste dans des contextes où des tensions identitaires influencent les évolutions linguistiques. Ainsi, Milorad Pupovac a observé que les différenciations entre le serbe et le croate, deux langues historiquement intercompréhensibles, se sont intensifiées sous l’effet de divisions sociales et politiques (Pupovac, 2008). De même, en Iran, les contextes sociopolitiques ont entraîné des oscillations entre l’arabisation et la persanisation du lexique, illustrant comment des dynamiques externes peuvent redéfinir les priorités linguistiques (Mahmoudian, 2009).
Ces observations conduisent à repenser les outils méthodologiques de la linguistique. Les approches classiques, souvent adaptées à des descriptions globales, peinent à saisir les nuances des pratiques locales ou individuelles. Martinet souligne que l’analyse des langues de grande diffusion peut se satisfaire de modèles relativement simples, mais que les variétés régionales, les dialectes et les idiolectes nécessitent des outils plus fins pour rendre compte de leurs spécificités (Martinet, 1945). Cette diversification des méthodes reflète un besoin croissant de modèles descriptifs qui s’adaptent aux particularités des échelles d’observation.
Les sciences physiques offrent un parallèle instructif. Comme le note Ilya Prigogine, les modèles déterministes classiques, bien qu’efficaces pour décrire des systèmes simples, montrent leurs limites face aux phénomènes instables ou complexes. De nouveaux cadres stochastiques ont été développés pour répondre à ces défis (Prigogine et Stengers, 1986). En linguistique, cette pluralité méthodologique se traduit par l’élaboration de modèles complémentaires, chacun adapté à une facette des phénomènes étudiés. Les travaux de William Labov illustrent cette approche, combinant des enquêtes quantitatives et qualitatives pour analyser les relations entre langue et société (Labov, 1976).
Enfin, l’éclatement des cadres linguistiques traditionnels ne signifie pas l’abandon de la notion de structure, mais une redéfinition de celle-ci. Dans la vision classique, une langue était conçue comme une entité unique et homogène. Aujourd’hui, il semble plus pertinent de parler de structures plurielles, chacune adaptée à un niveau d’analyse particulier. Cet éclatement reflète non seulement la complexité des pratiques linguistiques, mais aussi leur enrichissement par des dynamiques sociales, culturelles et psychiques (Mahmoudian, 2009).
En conclusion, l’évolution des théories linguistiques montre que l’hétérogénéité, l’ouverture et la diversification des fonctions des langues ne constituent pas des ruptures, mais des enrichissements. Ces avancées permettent de mieux comprendre les langues comme des systèmes vivants, en constante interaction avec leurs contextes sociaux et culturels. Cette perspective élargie renforce la pertinence de la linguistique en tant que science, capable de s’adapter à la complexité des réalités humaines.
Références bibliographiques
Bloomfield, L. (1957). A Set of Postulates for the Science of Language. In Martin Joos (Ed.), Readings in Linguistics. Londres et Chicago : Chicago University Press.
Labov, W. (1976). Sociolinguistique. Paris : Minuit.
Mahmoudian, M. (2009). Théorie linguistique face à la complexité des langues. La Linguistique, vol. 45, fasc. 2, pp. 3-30.
Martinet, A. (1945). La prononciation du français contemporain. Paris : Droz.
Martinet, A. (1960). Éléments de linguistique générale. Paris : Librairie Armand Colin.
Prigogine, I., & Stengers, I. (1986). La nouvelle alliance. Paris : Gallimard, « Folio-Essais ».
Pupovac, M. (2008). Identity Caused Diglossia on the Balkans. Communication présentée au colloque organisé par la section des langues slaves de l’Université de Lausanne sur le thème « Russie/Allemagne/France : Relations intellectuelles croisées », I : Langue et nation, Crêt-Bérard.
Weinreich, U. (1953). Languages in Contact. New York : Publications of the Linguistic Circle of New York.
Jocelyn Godson HÉRARD, Copywriter H-Translation

