La langue, loin d’être un système immuable et monolithique, est un objet vivant en constante évolution, tributaire d’une myriade de facteurs. Géographiques, sociaux, historiques ou encore situationnels, ces éléments façonnent et modèlent sans cesse les usages linguistiques. S’intéresser à cette variation inhérente à toute langue, c’est embrasser la richesse et la diversité des expressions humaines à travers le prisme de la parole vive.

Introduction
L’étude de la variation linguistique est un des piliers de la sociolinguistique moderne. Partant du postulat que nul ne s’exprime de manière identique en toutes circonstances, cette discipline se donne pour objet d’analyser les multiples paramètres contextuels, sociaux et individuels influant sur les usages d’une langue. Loin d’être une aberration, la variation est constitutive du fait langagier et en révèle toute la complexité. À la lumière des exemples du créole haïtien et du français, cet article se propose d’explorer les principaux axes de variation à l’œuvre, offrant un éclairage riche sur la vitalité de ces idiomes vivaces.
Variation diatopique
La variation diatopique joue sur l’axe géographique ; c’est la différenciation d’une langue suivant les régions qui relève de cette variation. Elle est la plus facile à repérer par les locuteurs. Certaines expressions sont typiques d’une région et permettent ainsi d’associer certains locuteurs à telle ou telle région ou « telle ou telle espace de vie sociale ». Cette variation est souvent appelée variation dialectale, dialecte ou topolecte parce qu’elle concerne les différentes façons dont la langue est parlée dans les différentes régions où elle est pratiquée. Ce type de variation jouant sur l’axe géographique influe aussi bien sur le lexique, la sémantique, la phonologie/phonétique que sur la morphosyntaxe de la langue.
1) Le lexique
Deux régions différentes peuvent ne pas avoir les mêmes expressions pour désigner la même réalité.
Dans le nord d’Haïti, le mot « pistach » utilisé dans l’ouest et le sud pour désigner la cacahuète se dit « anmizman ». Pour dire « accrocher quelque chose », le nord dit « pann » et le reste du pays dit « koke » ou « kwoke ».
2) La sémantique
Le même mot peut ne pas vouloir dire la même chose selon que vous êtes dans telle ou telle région.
Ce dernier exemple concernant la manière de dire « accrocher quelque chose » illustre bien les différences sémantiques qui peuvent être à la base de la variation géographique. Le mot « koke » dans la variété du nord a une connotation sexuelle alors que dans le reste du pays, il est inoffensif.
3) La phonologie/phonétique
Nous ne prononçons pas non plus les mots de la langue de la même manière. Par exemple, voici ce qu’a observé H. Walter en France en 1977 :
« Si, dans une boutique de Nice, on entend quelqu’un demander du lait ou du poulet en prononçant un [ɛ] ouvert, on dira qu’il « parle pointu » parce que les gens de la région sont surpris d’entendre un [ɛ] ouvert là où ils prononceraient un [e] fermé, comme dans les mots « thé » ou « épée ». Si la même scène se produit dans une boutique parisienne et qu’on entende quelqu’un demander du lait ou du poulet avec un [e] fermé, on dira de celui qui vient de parler qu’il a « l’accent du Midi ». Dans les deux cas, le bon sens populaire aura su relever des différences dans le comportement linguistique des locuteurs et on voit qu’il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste de la linguistique pour se rendre compte qu’il existe des différences entre les productions phoniques des usagers d’une même langue. »
4) La morphosyntaxe
La variation diatopique peut être observée même au niveau de l’organisation de la phrase. Dans le syntagme nominal du créole du nord, on peut par exemple trouver un « a » fonctif qui n’existe pas dans les autres variétés du pays. Le syntagme nominal « Pitit fi mwen » se dira dans le nord « Pitit fi a mwen ».
Le rôle de ce « a » ajouté dans la variété du nord, que le linguiste créoliste américain appelle un « a fonctif », est de renforcer le pronom personnel qui, associé au nom, assure l’expression du possessif. Dans ce cas, le fonctif a un rôle d’emphase.
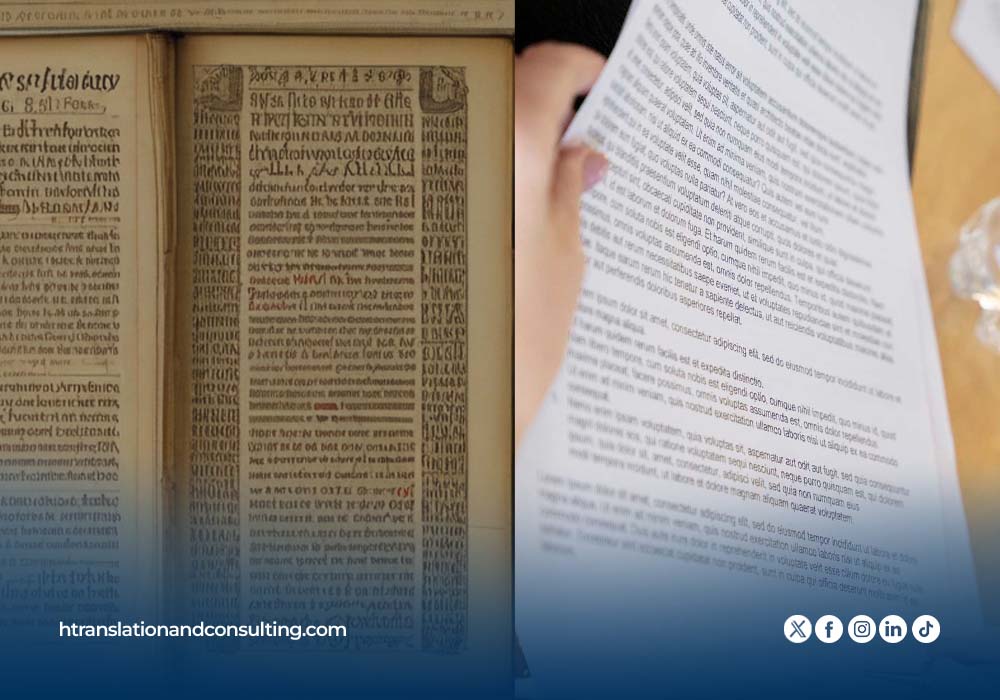
Variation diastratique
La variation diastratique explique les différences entre les usages pratiqués par les diverses classes sociales. On parle de ce type de variation, appelée aussi sociolecte, lorsque c’est l’origine sociale, l’appartenance à un milieu socioculturel qui est en cause. C’est ce type de variation qui fait la distinction entre la langue populaire et la langue soutenue.
Variation diachronique
La variation diachronique est celle que nous pouvons observer dans le temps. La langue parlée aujourd’hui n’est pas la même qu’il y a deux ou trois décennies. Beaucoup de créolophones haïtiens auront du mal à comprendre cet extrait de poème écrit en 1797 par Moreau de Saint-Méry et certains ne le comprendront peut-être pas :
« Si to allé à la ville,
Ta trouvé geine Candio
Qui gagné pour tromper fille
Bouche doux passé sirop.
To va crer yo bin sincère
Pendant quior yo coquin tro ;
C’est Serpent qui contrefaire
Crié Rat, pour tromper yo. »
Cette variation linguistique causée par l’action du temps peut s’observer notamment par la différence de langue qui existe entre deux générations. Les jeunes ne parlent pas comme les personnes âgées.
Variation basée sur le sexe
Au-delà des variations diatopique, diastratique et diachronique, il existe également une variation linguistique basée sur le sexe, qu’on appelle variation sexolectale. De nombreuses études ont montré que les hommes et les femmes n’utilisent pas toujours la langue de la même manière.
En Haïti par exemple, on observe que les femmes ont tendance à moins utiliser les jurons et les gros mots que les hommes. Elles privilégient un langage plus policé. À l’inverse, les hommes recourent plus facilement à un parler populaire émaillé d’expressions crues ou vulgaires.
Cette variation peut s’expliquer par les différences dans la construction sociale des genres, où les femmes sont généralement éduquées à se conformer aux normes de bienséance linguistique.
Variation diaphasique
Une autre source de variation est la situation de communication elle-même, ce qu’on appelle la variation diaphasique. Un même locuteur ne s’exprimera pas de la même façon selon qu’il parle en privé avec des amis, en famille, au travail, ou en public lors d’une conférence par exemple.
Son registre de langue variera en fonction du degré de formalité ou d’informalité requis par le contexte. En créole haïtien, on fera ainsi la distinction entre un registre familier utilisant de nombreux mots d’argot et un registre soutenu privilégiant un vocabulaire plus élaboré.
Variation diamésique
Enfin, les variations linguistiques peuvent aussi être influencées par le médium ou canal de communication utilisé, que ce soit l’oral ou l’écrit. C’est ce qu’on appelle la variation diamésique.
À l’écrit, que ce soit en français ou en créole haïtien, on aura tendance à soigner davantage son expression, à respecter les règles de grammaire et d’orthographe. À l’oral en revanche, le discours sera plus spontané et relâché, avec éventuellement des élisions ou des constructions fautives.
Conclusion
Au terme de cette exploration, il apparaît que la langue est un phénomène éminemment dynamique et pluriel, reflétant dans sa chair même la diversité des expériences humaines. Loin d’être un frein, ces multiples variations géographiques, sociales, historiques ou situationnelles sont la sève nourricière de l’arbre linguistique, garantissant sa pérennité et son foisonnement. Bien loin des normes artificielles, c’est dans l’embrassement de ces riches variations que réside la quintessence d’une langue vivante et vivifiante. Une invitation à savourer, avec l’œil du chercheur, la polyphonie des voix du monde.
Jocelyn Godson HÉRARD, Copywriter H-translation

